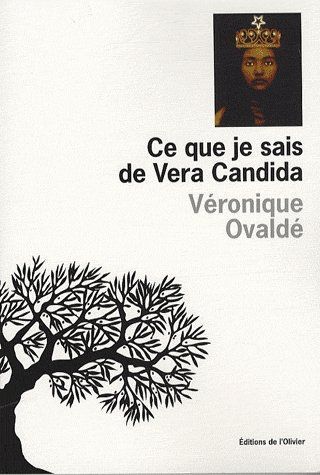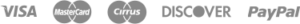CE QUE JE SAIS DE VERA CANDIDA
Ca fait un moment que je voulais te parler de ce bouquin!
Un vrai coup de coeur (encore un!). J’ai pas mis longtemps à le finir malgré mes travaux (le soir c’était un pur délice avant de m’endormir!).

C’est qui l’auteur ?
Après le bac, direction l’école Estienne où Véronique Ovaldé passe un BTS édition, une façon comme une autre d’entrer dans le milieu littéraire pour celle qui n’a pas eu la chance de naître au sein de ce cercle très fermé.
Elle se lance ensuite dans des études de lettres par correspondance alors qu’elle travaille comme chef de fabrication et publie en 2000 un premier roman, ‘Le Sommeil des poissons’ (Seuil). En 2002, paraît ‘Toutes choses scintillant’ (L’ Ampoule), une deuxième œuvre remarquée.
L’année suivante, elle signe chez Actes Sud ‘Les hommes en général me plaisent beaucoup’. Suivent ‘Déloger l’animal’, l’un des romans incontournables de la rentrée littéraire 2005, et ‘La très petite Zébuline’, un livre jeunesse avec l’illustratrice Joëlle Jolivet, en 2006, toujours chez Actes Sud.
Dans son roman à la fois sombre et merveilleux ‘Et mon cœur transparent’ (Éditions de l’Olivier, 2007), Véronique Ovaldé réussit une nouvelle fois à créer un univers singulier et reçoit le Prix France Culture/Télérama.
En 2009, nouveau succès au sein de la même maison d’édition : ‘Ce que je sais de Vera Candida’ reçoit le prix Renaudot des lycéens, le prix France Télévisions et le Grand prix des lectrices de Elle. Après le recueil de nouvelles ‘La Salle De Bains Du Titanic’ (J’ ai Lu), Ovaldé revient en 2011 avec ‘Des vies d’oiseaux’ (Éditions de l’Olivier).

C’est quoi l’histoire ?
Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire, trois femmes d’une même lignée semblent promises au même destin : enfanter une fille et ne pouvoir jamais révéler le nom du père.
Elles se nomment Rose, Violette et Vera Candida.
Elles sont toutes éprises de liberté mais enclines à la mélancolie, téméraires mais sujettes aux fatalités propres à leur sexe.
Parmi elles, seule Vera Candida ose penser qu’un destin, cela se brise. Elle fuit l’île de Vatapuna dès sa quinzième année et part pour Lahomeria, où elle rêve d’une vie sans passé.
Un certain Itxaga, journaliste à L’Indépendant, va grandement bouleverser cet espoir.
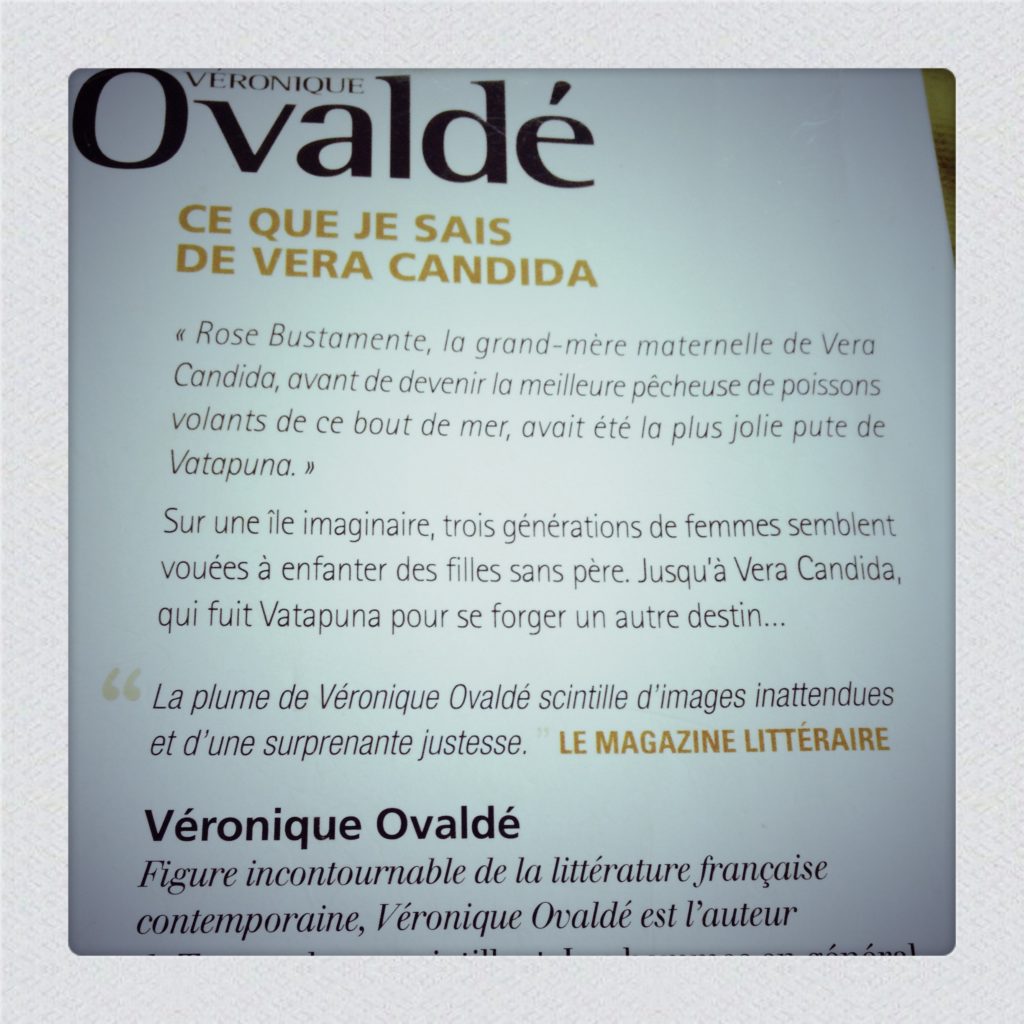
Ce que j’en pense
Ce que je sais de Vera Candida c’est qu’elle me manque! Ben Vi elle était devenue mon amie du soir, j’avais hâte de la retrouvé elle et sa famille!! J’ai aussi apprécié le personnage de sa grand mère un peu avant gardiste!
Bref tu l’auras compris j’ai adoré ce bouquin! Autant pour son exotisme : l’auteur t’emmène sur une île inconnue et inventée du coup libre à toi de te faire tes propres images et j’ai trouvé l’idée plus qu’interressante! Ca te met dans une atmosphère tropicale et cette chaleur va au dela de l’écriture : elle t’enveloppe!
Autant pour son histoire : les filles du roman forment une lignée condamnée par une fatalité! Mais pas que, il y aussi une histoire d’amour (ben vi!) une vraie pourtant improbable au départ! Ca parle aussi des liens filiaux, de la transmission familiale, en bref de l’hérédité!!
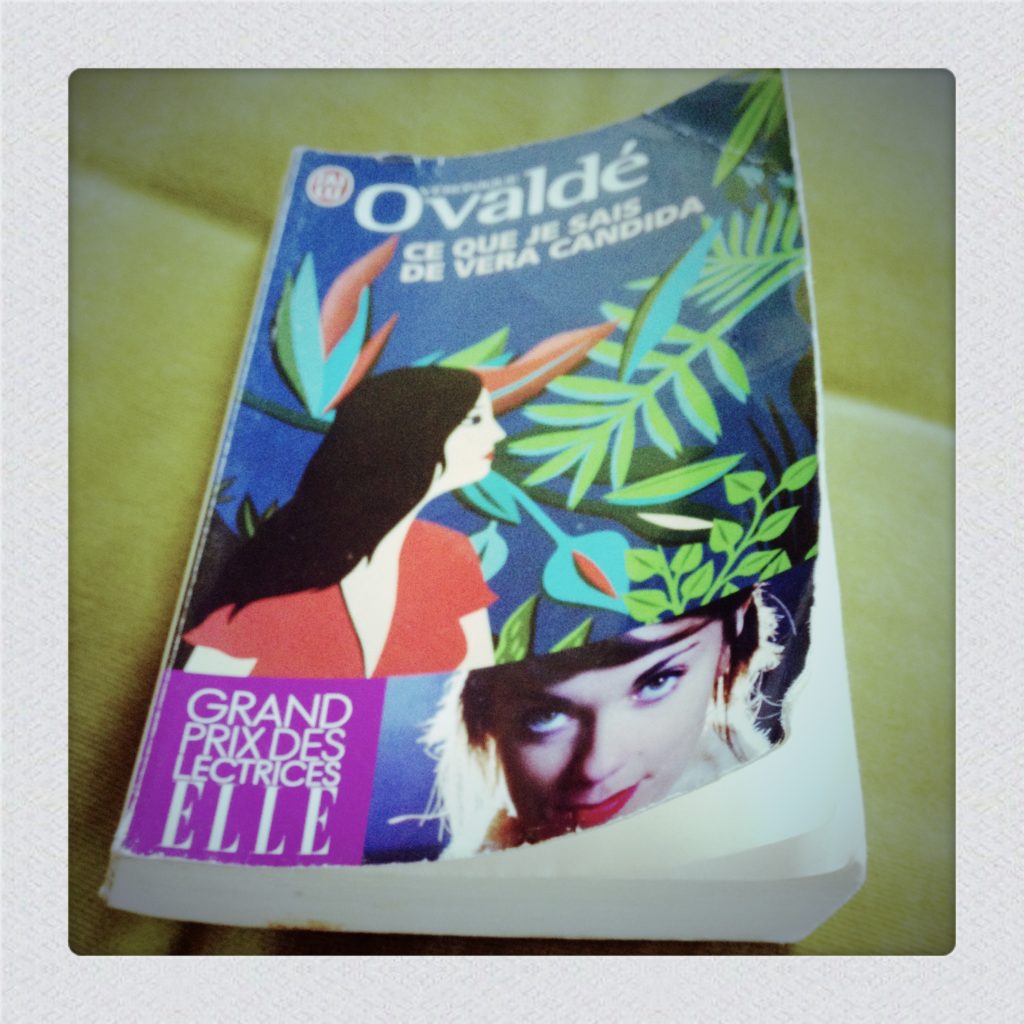 ‘Ce que je sais de Vera Candida’ puise au coeur de l’hérédité qui bat en chacun pour mieux saisir l’inconstance du destin!
‘Ce que je sais de Vera Candida’ puise au coeur de l’hérédité qui bat en chacun pour mieux saisir l’inconstance du destin!
Pour en savoir plus sur cet ouvrage clique ici (Vidéo de l’Auteur)
Extrait du Livre
Le retour de la femme jaguar
Quand on lui apprend qu’elle va mourir dans six mois, Vera Candida abandonne tout pour retourner à Vatapuna. Elle sait qu’il lui faut retrouver la petite cabane au bord de la mer, s’asseoir sur le tabouret dehors et respirer l’odeur des jacarandas mêlée à celle, plus intime, plus vivante, si vivante qu’on en sent déjà poindre la fin, celle pourrissante et douce de l’iode qui sature l’atmosphère de Vatapuna. Elle se voit déjà, les chevilles sur le bord d’une caisse, les mains croisées sur le ventre, le dos si étroitement collé aux planches qu’il en épousera la moindre écharde, le moindre noeud, le plus infime des poinçons des termites géants.Tout au long du voyage en minibus qui l’emmène du port de Nuatu jusqu’à Vatapuna, Vera Candida somnole en goûtant à l’avance la lenteur du temps tel qu’il passe à Vatapuna.
Vera Candida sait qu’en revenant à Vatapuna, elle récupérera son horloge. Celle qui ne ment jamais, qui ne fait pas disparaître comme par un enchantement malin les heures pleines, celle qui ne dévore rien et égrène avec précision, et une impartialité réconfortante, les minutes, qu’elles soient les dernières ou qu’elles ponctuent une vie encore inestimablement longue.
Il y a longtemps de cela, Vera Candida a perdu son horloge. C’est arrivé quand elle a quitté Vatapuna vingt-quatre ans auparavant. Elle avait pris dans le sens inverse le même minibus que celui-ci – moins rouillé sans doute, moins rafistolé avec des tendeurs et du gros scotch noir, moins bringuebalant et bruyant, moins sale, la route n’était pas encore visible sous les pieds quand on soulevait le tapis de sol, les pneus étaient moins lisses, mais le chauffeur était le même, des grigris jumeaux se balançaient au rétroviseur, juste empoussiérés maintenant et plus ternes, la radio diffusait déjà une soupe inaudible et criaillante, une sorte de continu crachotement de sorcière.
Vera Candida est seule dans le minibus, elle n’a plus de bébé dans le ventre, mais quelque chose de moins étranger et de plus destructeur, et elle n’a plus quinze ans.
Terminus, gueule le chauffeur.
Vera Candida s’empare de son sac à dos, elle le glisse sur ses épaules, les sangles lui blessent la peau, elle grimace, se dit, C’est ainsi que je sais que je faiblis, le type la regarde descendre, il se penche vers elle quand elle est sur la chaussée:
Je vous connais? lance-t-il.
Elle se retourne et le fixe. Il paraît gêné. Il dit:
Je croyais que je vous connaissais. Mais je vois tellement de gens.
Il fait un geste rond qui englobe la rue et les alentours déserts.
Vous ne pouvez pas me connaître, répond-elle. Elle sourit pour ne pas paraître trop abrupte. Elle sait quelle impression elle peut produire; elle a trente-neuf ans, à cet âge on sait quelle impression on produit sur ses contemporains. Elle devine le malaise du chauffeur, Vera Candida a le regard azur et féroce, ce qui coïncide mal. Elle a, depuis qu’elle est née, toujours gardé les sourcils froncés. Il y a des gens qui ne regardent jamais leur interlocuteur dans les yeux mais juste au-dessus, sur le point le plus bas du front, et ce décalage crée un trouble indéfinissable. Vera Candida a ce genre de regard, c’est comme un muscle de son visage qui serait toujours crispé, une malformation congénitale, impossible d’avoir l’air doux et attendri. Déjà minuscule, Vera Candida ne lâchait personne avec sa scrutation, elle semblait percer chacun à jour – sans que cela fût vrai d’ailleurs, Vera Candida n’avait pas ce pouvoir, elle ne faisait que fixer les gens comme l’aurait fait un bébé jaguar. Et on n’avait qu’une envie, c’était de décamper le plus vite possible.
Le chauffeur referme la porte coulissante et démarre.
Vera Candida pose son sac, elle respire l’odeur des palétuviers, la poussière de la route, le gasoil, et les effluves du matin caraïbe – le ragoût et les beignets -, elle perçoit le jacassement des télés et des radios par les fenêtres ouvertes – il doit être sept heures sept heures trente, estime-t-elle -, le ressac de la mer en arrière-plan, un chuintement discret, elle reprend son sac et traverse le village, se dirige vers la cabane qu’elle a quittée vingt-quatre ans auparavant.
Il y a un snack à la place.
Une baraque en tôle cadenassée. Vera Candida s’approche pour jeter un oeil à travers la porte vitrée, les relents persistants de graillon lui rappellent l’état de son estomac, elle se sent nauséeuse, elle jure entre ses dents, Putain de putain, elle s’attendait de toute façon à ce que la cabane en bois ait été rasée, c’était couru d’avance, elle le savait, n’est-ce pas, avant d’avoir entrepris le voyage, alors pourquoi a-t-elle entrepris ce voyage, elle entrevoit des tabourets retournés sur les deux tables et un comptoir bricolé avec du bois de récupération, elle s’assoit sur son sac et reprend son souffle, elle croise ses mains devant elle, voit ses doigts se superposer les uns aux autres, elle pense à ce que charrie son sang, elle pense à son corps qui déclare peu à peu forfait, elle a la tentation de se laisser aller à un désespoir tranquille. Elle ne se sent pas si mal, elle se sent juste en proie à la fatalité.
Pssst, entend-elle.
Elle lève le nez et aperçoit sur sa gauche, à travers le grillage, une petite vieille, les doigts accrochés au fil de fer, debout dans son jardin pelé, qui lui sourit d’un sourire de nourrisson édenté.
Pssst, répète-t-elle.
Vera Candida se remet sur ses pieds et se dirige vers la vieille, soupçonnant que la voix de celle-ci ne pourra venir jusqu’à elle, elle s’approche tout près de la vieille femme qui porte des breloques brillantes autour du cou, des médailles surdimensionnées et des sautoirs en strass, on dirait un catcheur, elle a l’air d’avoir sorti la totalité de son coffre à bijoux et enfilé tout ce que ses cervicales peuvent encore endurer, elle a un oeil morne et un oeil pétillant, elle semble avoir cent dix ans. Vera Candida regarde les doigts de la vieille accrochés au grillage comme des griffes de serin, elle dit, Bonjour.
Tu es Vera Candida, rétorque la vieille de sa toute petite voix. Elle toussote et ajoute, Ta grand-mère m’avait bien dit que tu reviendrais.
VATAPUNA
Les deux métiers de Rose Bustamente
Rose Bustamente, la grand-mère maternelle de Vera Candida, avant de devenir la meilleure pêcheuse de poissons volants de ce bout de mer, avait été la plus jolie pute de Vatapuna
Répudiée à quatorze ans par sa mère parce qu’elle n’était plus vierge, Rose Bustamente, avait vécu chez des cousins sur les hauteurs de Vatapuna. Les cousins en question étaient ceux dont les fils avaient fréquenté d’un peu trop près Rose Bustamente. On n’avait pas su si c’était pour cette raison qu’ils l’avaient accueillie chez eux. Ils l’hébergèrent pendant quelque temps avec une sorte d’indifférence fruste comme si elle avait été une biquette de plus.
Rose Bustamente avait fini par descendre à Vatapuna et faire ce que sa mère avait prédit qu’elle ferait: elle s’était mise à son compte dans la cabane, aujourd’hui transformée en snack miteux. Ses clients pouvaient baiser avec elle pour une somme raisonnable en écoutant la mer qui toussotait sur la plage tout devant, à l’abri derrière la portière en capsules plastique multicolores.
A quarante ans, se considérant trop vieille pour continuer son ministère, Rose avait cessé d’être pute. Elle ne se voyait pas travailler exclusivement de nuit pour ne pas effaroucher le chaland et n’imaginait pas se faire toute petite sur sa paillasse afin que ses rondeurs amollies passent pour des plis du drap. Elle s’était acheté une barcasse, une épuisette et un chapeau à large bord et s’était mise à pêcher les poissons volants (ou plutôt à les attraper comme s’ils avaient été des papillons) pour les vendre au marché le mercredi et le samedi. Elle était habile, délicate et dure à la tâche, toutes qualités qui lui avaient fort servi dans ses deux métiers.
Jusque-là Rose n’avait pas eu d’enfant parce qu’elle ne le pouvait pas, ce qui avait été bien pratique. Elle trouvait le monde assez instable et violent pour se réjouir ouvertement de n’avoir pu enfanter.
Très peu pour moi, disait-elle, assise à son étal sur le marché, à une ou deux vieilles commères près d’elle qui lui enviaient ses poissons volants et les bracelets qu’elle portait au poignet. J’ai le ventre sec et la vie plus simple. Et les vieilles acquiesçaient en la plaignant et en la jalousant tout à la fois, causant dès qu’elle avait son joli dos tourné, Elle fanfaronne mais elle est bien malheureuse, la pauvresse, personne ne s’occupera d’elle dans ses vieux jours, ni mari ni enfants, oubliant, les cousines, combien leurs maris étaient choses volatiles et que leurs enfants avaient eu tôt fait de quitter la cabane pour tenter de voler de leurs propres ailes, s’abstenant de retourner auprès de leur vieille maman même dans ses dernières heures.
Rose n’avait jamais été importunée à cause de son premier métier, ni pendant qu’elle l’exerçait ni après qu’elle l’avait abandonné. Les femmes avaient été assez naïves pour penser qu’avec une Rose au village leurs hommes n’iraient jamais chercher plus loin et elles étaient assez rouées pour lui être reconnaissantes de faire ce qu’elles-mêmes ne voulaient plus faire aussi souvent et avec d’aussi jolies simagrées qu’au début de leur mariage.
Rose avait donc eu la paix pendant des années et sa vie ne se compliqua qu’avec l’arrivée de Jeronimo à Vatapuna.
Blanche avec des ailerons
Rose connaissait déjà deux trois choses à propos de Jeronimo quand elle apprit qu’il approchait du village. Sa réputation l’avait précédé comme c’est le cas pour tous les brigands, les joueurs professionnels ou les play-boys aux yeux verts. Même dans cet endroit reculé du monde, à l’extrémité ouest de l’île, dans le village de Vatapuna, on avait eu vent de Jeronimo.
Ce fut au marché que Rose fut informée de son arrivée. On avait l’impression d’entendre parler d’un cyclone, trajet, force des vents, espoir d’y échapper, certitude de finalement se retrouver pile au centre de son oeil. Rose vendait ses poissons volants sans se préoccuper outre mesure de la rumeur, elle avait mis au point des techniques d’évitement, l’air d’être là sans y être, le sourire entendu, le hochement de tête, une absence étudiée et bienveillante comme si tout cela ne l’affectait pas directement, elle aurait bien aimé certes être concernée, mais, allez savoir pourquoi, les rumeurs ne réussissaient jamais à la passionner ou à la faire sortir de ses gonds.
Bonne Lecture!